QUAND LES MOTS SE TRANSFORMENT EN MAUX
On m’a souvent dit que l’une de mes premières qualités était mon honnêteté et ma sincérité.
De la même manière, on m’a aussi souvent dit que mon plus gros défaut était de dire trop ouvertement ce que je pensais.
De fait, l'un des plus grands dilemmes de ma vie est de savoir ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire, ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire.
Histoire de complexifier encore la chose, on a récemment et à plusieurs reprises loué mon “authenticité”.
Si vous me lisez depuis le début, peut-être avez-vous remarqué que j’ai, en effet, plutôt tendance à dire ce que je pense.
Ce qui ferait de moi quelqu’un d’authentiquement sincère. Ou sincèrement authentique. Je ne sais pas.
Si cela peut en inspirer certains, cela peut également en heurter d’autres.
En fait, depuis que je suis petite, je ne cesse de heurter en étant trop franche, trop directe, trop jugeante, trop “bavarde”.
Et je pense que personne n’est vraiment fier de heurter les gens qu’il aime.
Pire, cela fragilise votre rapport à vous-même : culpabilité, honte, peur constante, distance avec les autres, blocages émotionnels, interprétations, ruminations, perte d’estime de soi.
J’ai même fini par me demander si j’étais autiste face à mon incapacité à savoir ce que je dois dire ou ne pas dire et, le cas échéant, dans quelles proportions.
D’ailleurs, même ça, je me demande si je peux le dire.
Mais c’est là qu’un profond mystère se pose : comment savoir si notre interlocuteur va être bouleversé par l’une de nos paroles, alors qu’il nous est tout bonnement impossible de marcher dans sa tête ?
Certaines choses, anodines pour nous, peuvent être profondément troublantes pour les autres.
De ce fait, n’y aura-t-il pas toujours quelqu’un pour se sentir offusqué par nos paroles, par nos actes ?
À moins que ce ne soit là qu’une excuse de ma part pour ne pas changer.
Un peu comme ces gens colériques dont le fusible saute à tout moment et qui se targuent de répéter : “ET SI ÇA PLAÎT PAS, C’EST PAREIL !”
Après tout, il est plus aisé de se dire que l’on “est comme ça” plutôt qu’affronter la réalité qui est : on peut tous changer, à condition de le vouloir.
Et moi, je ne veux pas finir conne et seule. Alors j’essaye de changer.
Et changer, ça passe par comprendre.
Alors j’ai essayé de comprendre la source de cette loquacité, la faille qui se cachait derrière.
Une fois identifiée, j’ai mis en place des techniques, telles que la communication non-violente.
LA NON-VIOLENCE
Alors que j’étais en Master, une psychanalyste est venue nous présenter le principe de la communication non violente.
Consciente de cette grande faculté à blesser, couplée à une impulsivité enfantine, une colère noire et une rage qui brûlaient en moi, j’ai immédiatement été séduite par cette technique.
En même temps, apprendre que l’on peut dire à quelqu’un : “Quand tu arrives en retard, j’ai l’impression que tu me manques de respect, comme si ton temps avait plus de valeur que le mien” au lieu de “Putain, mais t’es vraiment un connard ! À cause de toi, j’aurais pu travailler 30 minutes de plus si seulement tu m’avais prévenue”, ça ne laisse personne indifférent.
Ça m’a permis de comprendre qu’au lieu d’agresser et de reprocher, nous pouvons nous concentrer sur nos propres ressentis et que le résultat est cent fois plus efficace.
Pas inutile, ma foi.
Surtout dans une société où la violence verbale est hyper-généralisée.
Avec le temps, j’ai fini par saisir que la violence verbale, c’est ni plus ni moins l’expression maladroite d’une souffrance intérieure. Crier, accuser, insulter… Au fond, ce qui se cache derrière, c’est souvent un besoin non comblé : être entendu, reconnu, respecté. Une tentative désespérée de reprendre un pouvoir qu’on a l’impression d’avoir perdu.
Le pire dans tout ça, c’est que hurler n’a jamais calmé personne.
En fait, ça laisse même un arrière goût de culpabilité, de honte car la plupart du temps, nous ratons notre cible.
J’ai trouvé beaucoup de réconfort dans cette technique qui, croyez-moi, n’est pas si simple que ça à appliquer au vu de ce à quoi nous sommes habitués.
Mais la violence verbale, elle est insidieuse. Elle s’immisce parfois là où nous ne l’imaginons pas.
C’est pourquoi, alors que je pensais n’aller que vers du positif, j’ai été une fois de plus rattrapée par une réalité que je connais trop bien : ce que nous disons est parfois très éloigné de ce qui est entendu.
En l’espace de quelques publications, alors que je voyais dans mes textes un appel à la bienveillance, à l’amour, à l’harmonie, à la liberté et à l’écoute de soi, j’ai suscité des émotions qui n’étaient pas agréables pour certains à tel point que mon père m’a dit “de faire attention”.
A peine artistée, déjà censurée. Snif.
Alors, cela m’a amenée à me poser tout un tas de questions : pouvons-nous être pleinement authentiques sans heurter les autres ? Pouvons-nous tout dire sous couvert de sincérité ? Si non, comment savoir quand se limiter ? Devons-nous nous exprimer uniquement lorsque nous avons la légitimité pour ? Si oui, à partir de quand l'avons-nous ? Sommes-nous responsables des réactions négatives des autres à nos paroles ? Est-il possible d’anticiper les réactions des autres ? Est-ce à moi de me restreindre ou aux autres de faire face à leurs émotions ?
À défaut d’avoir trouvé les réponses à toutes ces questions, je vous partage mes pensées, en vrac, afin que vous soyez libre de prendre ce qui vous parle et laisser le reste.
LA PUISSANCE CRÉATRICE DES MOTS
Alors que j’étais en Martinique, je lisais pour la première fois Les Accords Toltèques de Don Miguel Ruiz (qui selon moi, devrait trôner sur toutes tables de nuit).
Issu d’une lignée de chamans mexicains, l’auteur partage quatre règles pour se libérer des croyances limitantes et du conditionnement collectif basé sur la peur, afin de retrouver l’amour inconditionnel qui nous constitue tous.
La première de ces règles est : “que votre parole soit impeccable”.
L’idée générale qui se cache derrière ça c’est que notre parole aurait un pouvoir créateur : chaque être humain serait un magicien capable de lancer des sorts à travers chaque mot. Des sorts doux, comme des sorts maléfiques.
D’où l’importance de veiller à ce que l’on dit.
Alors que j’étais en Inde à étudier le yoga, j’ai découvert que les Védas, texte fondateur de l’hindouisme, véhiculaient une théorie similaire à celle des toltèques.
Il y est enseigné que les mots sont porteurs d’une fréquence vibratoire : chaque son et chaque syllabe émettent une énergie subtile qui agit sur notre environnement et notre état intérieur.
D’où l’importance des mantras, ces phrases ou mots sanskrits considérés comme une énergie mystique enfermée dans une structure sonore (son=vibration=énergie) dotée de vertus spécifiques.
Certains sont même gardés secrets. Il est dit qu’ils seraient dévastateurs s’ils tombaient entre de mauvaises mains; une vision qui fait écho à l'idée de “sort” dans la pensée toltèque.
Cela m’a fait penser à la “magie noire” dont ma collègue malienne me parlait si souvent et que j’ai par la suite retrouvée en Martinique sous le nom de “quimbois”.
Ca m’a également fait penser aux livres de Luis Ansa et Victor Castaneda que j’ai lus sur le chamanisme sud-américain dans lesquels les deux font état de sorcier et sorcières.
En me renseignant, j’ai découvert que l’importance de la parole ne se limitait pas aux traditions toltèques ou védiques.
Dans l’islam, le Coran provient du mot "qara’a" signifiant "réciter". La parole y est sacrée et il y est dit que la langue peut être une bénédiction ou une arme.
Dans le judaïsme, la Génèse évoque la création du monde par la parole : "Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut."
La Kabbale (tradition mystique juive) va plus loin, attribuant à chaque lettre hébraïque une énergie particulière (et hop petit clin d’oeil subtil à la numérologie basé sur les lettres du prénom/nom pour calculer les énergies propres à chacun).
Quant au christianisme : "Au commencement était le Verbe..."
Finalement, peut-être que la fameuse phrase “tourner sa langue sept dans sa bouche avant de parler” que ma mère a eu l’occasion de me répéter plus d’une fois n’est autre que la version athée de toutes ses traditions.
É-MOT-IONS ET HOR-MO-NES
Sur le plan scientifique, il a été prouvé que les mots influencent nos émotions , sculptent notre perception du monde mais aussi influencent nos réactions physiologiques.
La preuve en est avec les effets placebo et son contraire nocebo.
De même, des études ont montré que les mots - prononcés ou écoutés - activent des zones cérébrales comme l’amygdale (liée aux émotions) et le cortex préfrontal (lié à la réflexion et aux décisions).
Plus intéressant encore, les mots sont créateurs d’hormones!
Andrew Newberg et Mark Robert Waldman, deux neuroscientifiques ont démontré que les mots négatifs tels que "peur" et "haine" stimulent le cortisol (hormone du stress), tandis que les mots positifs tels que “paix" et "amour" libèrent de l’ocytocine (hormone du bien-être).
C’est la raison pour laquelle il est d’usage de méditer en pensant à des émotions telles que l’amour, la joie, la gratitude, ou de visualiser des personnes/des situations/des lieux que l’on aime.
En définitive, que les mots soient perçus comme des sortilèges, des vibrations, des forces créatrices ou des déclencheurs chimiques, il n’en demeure pas moins qu’une pensée commune se dégage de tout cela : les mots ont un impact réel sur notre état d’esprit et notre réalité.
Métaphores ou réalité, l’effet placebo nous prouve que ce à quoi nous croyons façonne notre réalité intérieure.
Il nous appartient donc de choisir — en pleine conscience — ce que nous voulons croire et ce que nous voulons laisser résonner en nous et en les autres.
Car les mots laissent une empreinte.
Une empreinte invisible - mais bien réelle - sur notre être et sur celui des autres.
Raison pour laquelle nous devons veiller à avoir une parole “parfaite”.
UNE PAROLE PARFAITE
Récemment, j’ai découvert que le bouddhisme, au même titre que les quatre accords Toltèques, faisait état de quatre nobles vérités censées mettre fin notre souffrance.
Dans l’une de ces quatre vérités, on trouve notamment “la parole parfaite” : soit une parole juste, dénuée de jugement, de médisance, de haine, de mensonge, de futilité.
Ca m’a de suite fait penser au Test de la Passoire de Socrate, qui consiste à ne parler que si notre parole remporte le test des trois passoires :
première passoire : ne parler que si nous sommes sûrs que ce que nous nous apprêtons à dire est VRAI,
deuxième passoire : ne parler que si notre parole est BONNE,
troisième passoire : ne parler que si notre parole est UTILE.
Je ne sais pas vous, mais moi ça m’a bien fait redescendre sur Terre cette histoire de passoires.
Car en se mettant à l’appliquer, il est frappant de constater que peu de nos paroles sont vraies, bonnes ET utiles.
En fait, ce projet entier est même remis en question. Mais dans un sens, qui peut juger ce qui est en vrai, sachant que nous vivons tous la vérité de manière parfaitement subjective ?
De même, rares sont les paroles “parfaites” car nous nous positionnons constamment en qualité de juge des autres, croyant savoir/faire mieux que tout le monde, au regard de cette même vérité qui est la nôtre.
En tout cas, une chose est sûre : la plupart de nos échanges relèvent d’une profonde futilité. Des échanges que l’on partage par bienséance, par politesse, par obligation ou même par fuite d’aborder ce qui importe véritablement.
Du coup, pour la première fois de ma vie, j’apprends à me taire.
Et en me taisant, j’apprends à écouter davantage — les autres, le monde, et surtout, moi-même.
PETITE ÉLOGE DU SILENCE
S’il y a bien un mot qui est l’exact opposé de ce que je suis, c’est bien silence.
Je pense même détenir le record du nombre de maux de tête infligés à des tierces personnes.
A tel point qu’en sixième, en cours d’arts plastiques, alors que nous devions créer un autoportrait, je me suis représentée avec un t-shirt fait de papier journal et une croix en gros scotch noir à la place de la bouche.
Ca pourrait être drôle si cela n’était pas accompagné de rêves récurrents que je fais depuis que je suis gosse dans lesquels je suis en danger et qu’aucun son de sort de ma bouche alors que je crie.
L’avantage c’est que j’ai toujours cherché à analyser mes rêves. Alors j’ai vite su identifier que ma loquacité était en fait due à une peur de ne pas être considérée, écoutée.
Du fait de cette peur, j’ai cru que je devais combler tous les trous, tous les vides, afin de ne pas laisser l’autre croire que je n’avais rien à raconter.
Puis, un jour, j’ai découvert le yoga et toute ma vie en a été bouleversée.
J’ai appris à ralentir, à respirer, à me taire.
J’ai découvert le silence, extérieur comme intérieur, et sa préciosité.
Car s’il est bien utilisé, le silence permet alors une re-connexion avec son être.
Il permet de mettre sa vie sur pause un instant, afin de plonger à l’intérieur de soi : Comment est-ce que je me sens ? Comment cette émotion, ce ressenti, se manifestent-ils ? Ai-je mal quelque part ?
D’ailleurs, en Inde, dans la salle de repas il y avait une pancarte :
Alors depuis, j’essaye d’être le plus silencieuse possible afin de trouver les réponses.
Et force est de constater que ça marche plutôt pas mal si je fais la rétrospective de mon évolution sur ces deux dernières années.
Vous savez-vous le plus inattendu dans tout ça ? Mon débit de paroles a même ralenti.
PETITE ÉLOGE DU RALENTISSEMENT
Depuis que je me suis envolée en Martinique il y a plus d’un an, mon train de vie a changé du tout au tout car j’ai appris à ne rien faire.
Alors que cela m’était absolument envisageable auparavant, je suis capable de regarder un paysage pendant deux heures sans bouger, à ne rien faire d’autre qu’apprécier ce qui se trouve en face de moi.
Et j’ai tellement de réponses qui sont venues à moi en l’espace d’un an que j’ai dû les écrire.
J’écris partout. J’écris nulle part.
J’écris à moi-même. J’écris aux autres.
J’envoie, je garde, je brûle. Peu importe, faut que ça sorte.
C’est pas toujours joli mais au moins ça donne quelque chose de sincèrement authentique, comme ce texte.
Parce que je crois qu’au fond il n’y a pas meilleure définition de l’authenticité : savoir présenter au monde ses qualités, comme ses défauts.
Sinon, on livre une image incomplète de notre personne et on trompe.
On se trompe soi-même. On trompe les autres.
Si je voue un amour à l’écriture et ses vertus, une chose me saute aux yeux cependant : je n’arrive pas à structurer mes pensées.
En même temps, comment structurer quelque chose lorsque qu’on est soi-même déstructuré ?
D’ailleurs c’était la conclusion de ma première séance de psychothérapie : “vous me semblez être quelqu’un de très contradictoire : vous dîtes tout et son contraire”.
Moi ? Tiens donc?
J’ai finalement compris que l’écrit représentait pour moi plus qu’un moyen d’expression mais un besoin, une nécessité.
Pour structurer mes pensées mais également pour ralentir.
Ralentir cette course effrénée que je mène contre moi-même qui me pousse à visualiser toujours plus de contenus, lire toujours plus de livres, rencontrer toujours plus de personnes, faire toujours plus de choses, travailler toujours plus, parler toujours plus.
Pour être vue, entendue, acceptée, considérée, aimée.
J’ai finalement compris que le trop-plein de tout n’était là que pour tenter de combler un vide intérieur.
Et ça fait un bien fou de ralentir, surtout quand on s’appelle Eléa Alessandri et que l’on a une fausse croyance selon laquelle faire vite = faire bien.
Pourtant, c’est pas faute à maman de m’avoir toujours répété “ne pas confondre vitesse et précipitation”.
Alors je ralentis.
Et quand je ralentis, j’écris.
Et je crois qu’il n’y a pas de hasard si dans le mot “écrire”, on y trouve le mot “cri”.
Car dans mes textes, je crie.
Je crie tout ce qui n’est pas sorti, tout ce qui ne veut pas sortir, tout ce qui ne peut pas sortir, tout ce qui se tait, en espérant un jour atteindre ma cible.
J’écris ce qui est tapi dans l’ombre, afin de faire jaillir la lumière.
Parce qu’au fond, que serait la lumière sans ombre?
Après tout, on est ce qu’on est grâce - et non malgré - ce que nous avons traversé.
Le tout, c’est de le processer, de l’accepter et d’avancer.




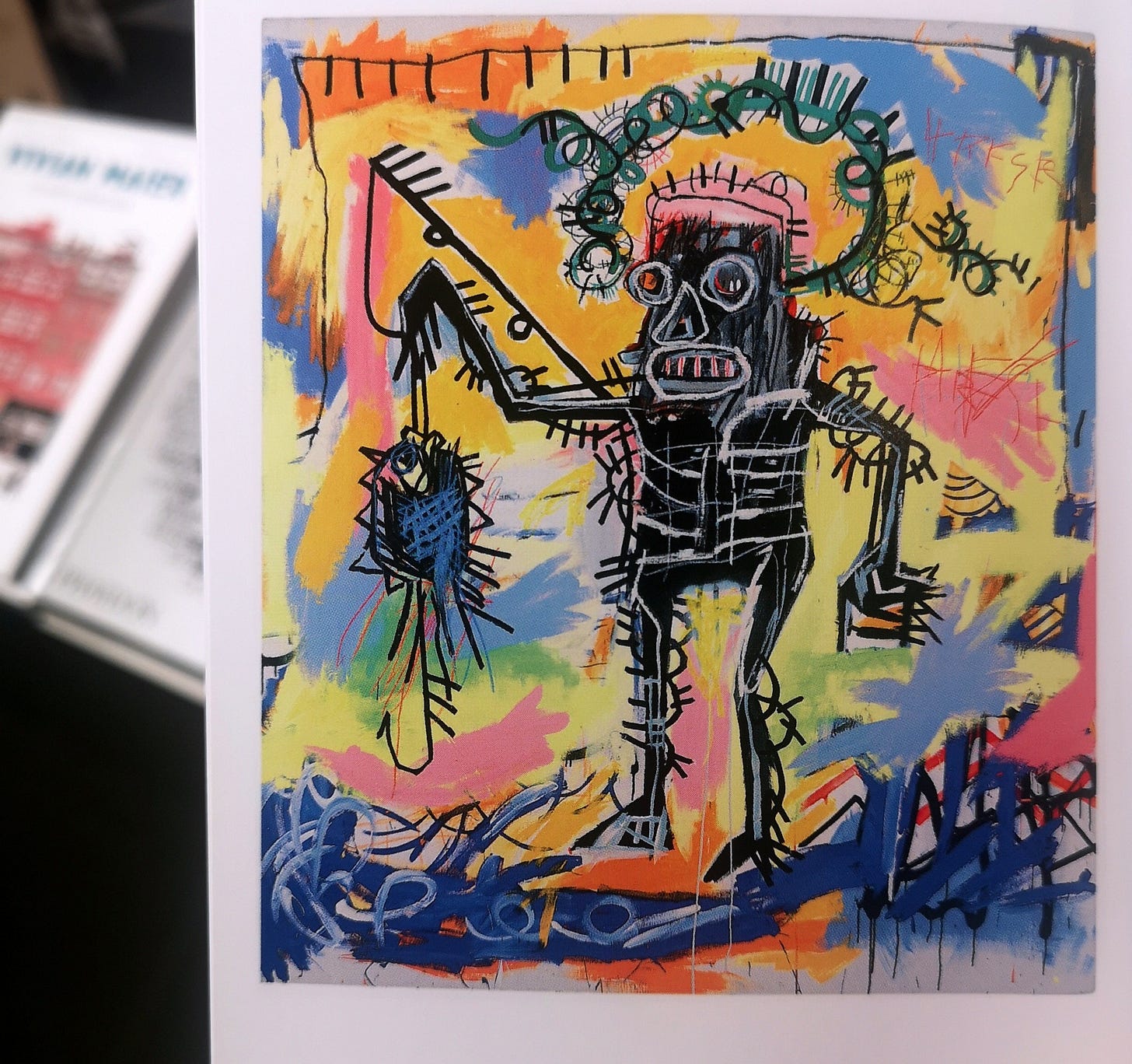



Alors, je te découvre tout juste, au même moment où je découvre cette application, à vrai dire.
Je compte écrire, moi aussi, quelques ébauches de mes pensées. Certaines sont déjà rédigées et gardées dans mon coin, tandis que d’autres ne sont encore qu’au stade d’ébauches.
J’espère ne pas déranger en répondant avec ma vision de la vie, qui est peut-être différente, mais qui, je l’espère, pourra apporter un éclairage ou une perspective nouvelle.
Ton post m’a profondément touché, car il a réveillé en moi des échos familiers. Il m’a rappelé mon propre cheminement, mes luttes et mes prises de conscience sur la puissance des mots. J’ai appris, parfois à mes dépens, que chaque parole peut construire ou détruire, et que la maîtrise de ce que l’on dit est l’une des clés d’une vie apaisée et authentique. Aujourd’hui, je m’efforce de choisir mes mots avec soin, car ils sont le reflet de ce que je suis et de ce que je veux apporter au monde.
Pour réagir en partie à ton post, je te citerais ces phrases qui me sont venues immédiatement à l’esprit en te lisant (au-delà, peut-être, d’une indifférence de ta part aux sujets religieux). J’ai fait en sorte que ce ne soit pas trop précis sur les noms, qui ne te seront pas utiles, et d’éviter les détails trop poussés, afin que cela reste en lien avec ton post et le sujet évoqué :
1 - « Celui qui croit en Allah et au Jour dernier, qu’il dise une bonne chose ou qu’il se taise. »
2 - « Quiconque me garantit ce qu’il a entre ses deux mâchoires (la langue), je lui garantis le Paradis. »
3 - « Celui qui garde le silence est sauvé. »
4 - « Il arrive que le serviteur prononce une parole, sans se rendre compte de sa gravité, qui le plonge en Enfer à une profondeur plus grande que la distance entre l’Orient et l’Occident. »
5 - Un compagnon vint le voir et lui demanda : « Qu’est-ce qu’être sauvé ? » Il répondit : « Retiens ta langue, que ta maison te suffise, et pleure pour tes péchés. »
6 - Le Prophète lui dit : « Ne t’informerais-je pas de ce qui contrôle tout ceci (d’innombrables bonnes actions) ? » Le compagnon répondit : « Bien sûr, ô Prophète. » Il saisit sa propre langue (pour montrer l’importance de la maîtriser) et dit : « Contrôle ceci ! » Le compagnon demanda : « Ô Prophète, serons-nous tenus responsables de ce que nous disons ? » Il répondit : « Que ta mère te perde (ancienne expression) ! Les gens ne sont-ils pas jetés en Enfer sur leurs visages à cause de leurs langues ? »
7 - Un compagnon vit un autre compagnon saisir sa propre langue et dit : « Ô la langue ! Dis du bien, tu obtiendras un butin ; tais-toi sur le mal, tu seras préservée avant de regretter. » Puis, le compagnon qui avait saisi sa langue ajouta : « J’ai entendu le Prophète dire : “La plupart des péchés du fils d’Adam (les humains) proviennent de sa langue.” »
Ces citations, bien qu’issues de la tradition islamique, portent une sagesse universelle sur l’importance de la parole et du silence.
Loin de moi l’idée de faire du prosélytisme. Je voulais simplement réagir à ton post, car il m’a parlé au plus profond. J’ai longtemps été une personne qui faisait du mal (avec ma langue) à ceux qui ont foulé la terre en ma compagnie, sans distinction familiale ou amicale. Aujourd’hui, j’essaie de me taire, de dire le bien et de sourire. Nous avons tant à apprendre des autres, dans le respect.
J’espère que ces mots t’apporteront autant de réflexion et de paix qu’ils m’en ont apporté. Nous avons tous la capacité de grandir et de nous améliorer, un mot à la fois. Chaque parole que nous choisissons de dire ou de taire est une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et cela, c’est un cadeau que nous pouvons nous offrir mutuellement.